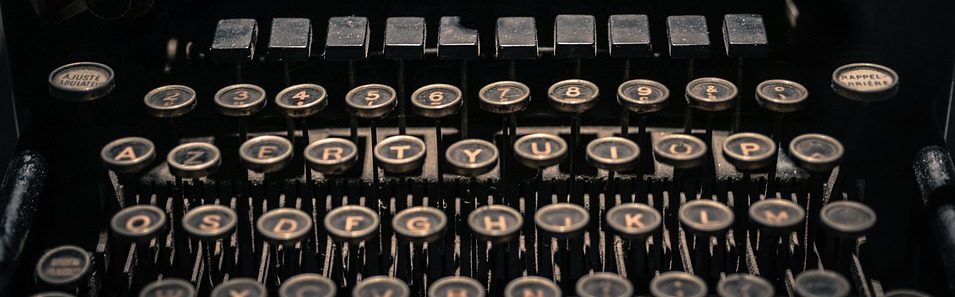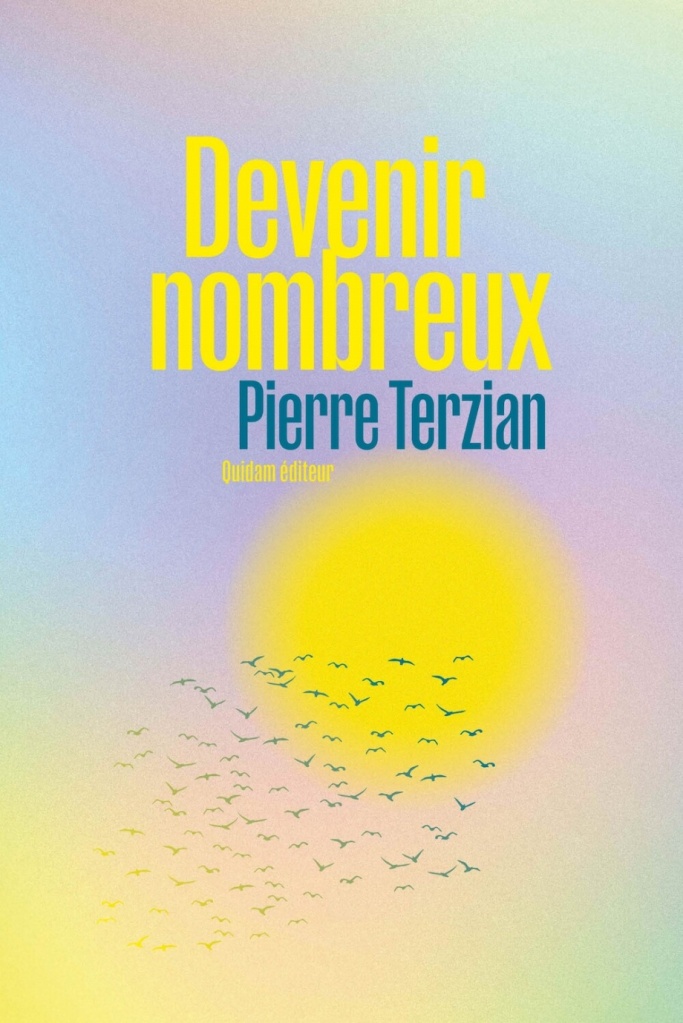
Le plus récent roman de Pierre Terzian, Devenir nombreux, décrit le voyage périlleux de Samuel et de sa soeur Betty depuis une France déchirée par des conflits armés jusqu’au Québec. Les deux réapprennent à vivre au sein d’une communauté, L’Enclave, qui s’est établie en pleine nature et qui tente d’améliorer l’expérience humaine dans un esprit d’équilibre constant. Plus qu’une dystopie, le livre propose une véritable utopie où même la technologie est organique, rassembleuse, poétique. Le roman n’efface ni les doutes ni les obstacles. Il favorise tout simplement le rêve à l’encontre de la soumission aux modèles économiques et sociopolitiques dépassés. Entretien avec un artiste philosophe tout terrain qui a voyagé et qui croit possible un futur meilleur.
Comme dans le livre, toute expérience d’émigration porte son lot de désillusions, mais l’histoire humaine démontre qu’un périple de survie représente l’une des plus vieilles activités du monde, nécessaire, voire vitale. Est-il possible de ne jamais changer, s’adapter, bouger ?
Étant issu de la rencontre entre une Danoise qui a quitté son pays pour le Paris de la Nouvelle Vague, et d’un Arménien dont la famille a fui le génocide en 1915 en Turquie pour immigrer en Bulgarie, puis en France, j’ai poursuivi cette tradition du déplacement en m’installant au Québec en 2012 après avoir rencontré une Québécoise, et fondé une famille ici, donc je ne saurais te contredire : la vie est faite de mouvement, et c’est là qu’elle prend tout son sens. Mais je tends de plus en plus, notamment en ce qui concerne l’écriture, à me façonner une routine, un quotidien plus sédentaire, auquel j’accorde beaucoup d’importance, et je réserve de plus en plus ce mouvement à la fiction. C’est une nouvelle étape de ma vie. L’écriture de ce roman a été très agréable, en ce sens, car il est traversé par l’urgence de changer, de bouger, de reconstruire, d’envisager l’avenir autrement.
La pandémie semble avoir hausser le niveau d’inquiétude général, et des artistes particulièrement, à propos de l’avenir. Dans plusieurs disciplines, les dystopies proposent souvent une reconnexion avec la nature, une vie plus simple. Peut-on y arriver ?
L’idée de ce livre est née en 2015, lorsque les dystopies n’inondaient pas encore l’espace culturel comme elles le font aujourd’hui. Je l’ai laissé de côté et repris pendant la pandémie. À ce moment-là, on avait tellement le nez dans la dystopie réelle que j’ai senti l’obligation de la tordre en utopie. À quoi servait d’ajouter de l’horreur, de la peur à ce qu’on vivait ? Le tableau était suffisamment noir. Je me suis forcé à imaginer une trajectoire différente. J’ai fait l’effort mental de renouveler mon propre imaginaire. Mais je ne cherchais pas une utopie parfaite, à l’eau de rose, trop naïve, je voulais définir une utopie complexe, avec sa part d’ombre, de sacrifices et de doutes, mais une utopie quand même, dans le sens où le personnage principal et sa soeur découvrent dans l’Enclave un mode de vie et une organisation sociale dont ils ignoraient l’existence et même la possibilité avant de la rejoindre. C’est le déroulement concret de ce « rêve » que j’avais envie de travailler. Faire traverser physiquement, sensitivement, le quotidien de cette communauté au lecteur. Alors évidemment, il est difficile de contourner les clichés de la communauté hippie et de la décroissance. Le « retour à la nature » est lui aussi de plus en plus galvaudé et redigéré par la société marchande (toutes les annonces de VUS en font l’apologie). Mais ce n’est pas tant le « retour à la nature » qui est en jeu ici, pour sa seule saveur exotique, déroutante, mais l’arrachement, le dépouillement, voire même la souffrance nécessaire pour réinventer notre mode de vie et notre rapport aux autres. La communauté de l’Enclave ne retourne pas (seulement) à la nature : elle s’est isolée pour réinventer l’humain, sur un mode radicalement égalitaire, communiste, où la propriété individuelle n’existe plus. C’est assez différent. Car comme tu le sous-entends, un « retour à la nature » qui serait l’apanage des dominants prenant conscience de l’obscénité de leur mode de vie, et qui s’inscrirait dans le système capitaliste tel qu’on le connaît mais simplement « verdi », relève pour moi de la dystopie et non de l’utopie. C’est même la mutation la plus cynique d’un système qui n’en finit pas de l’être.

Un autre élément du livre est que l’humain ne peut pas vivre seul. Toutes les sortes de famille sont évoquées dans le récit. On semble y croire tous en théorie, mais on s’aperçoit qu’en société, les nez plongés dans le cellulaire dans un individualisme ambiant font en sorte que le collectif et l’esprit de communauté ne semblent plus être des valeurs courantes ?
Les « communautés » sont partout aujourd’hui, mais bizarrement, on ne s’est jamais senti aussi seul. Parallèlement à l’écriture, je travaille en théâtre d’intervention, croisant la route de nombreux acteurs et actrices amateurs dans des milieux très différents, notamment des jeunes. On en parle un peu plus aujourd’hui, mais pas assez à mon goût, parce qu’on est tous concernés et secrètement sidérés, je crois : à leur contact, il est triste de constater à quel point l’intrusion de la technologie a modifié leur rapport au temps et aux autres. Évidemment, on ne peut pas accuser la technologie d’être à l’origine de l’individualisme du modèle de société que propage l’Occident, mais on peut certifier qu’elle en a normalisé certains aspects les plus terrifiants, notamment lorsqu’on parle de ce que tout le monde appelle « l’attention ». J’aime rappeler aux jeunes avec lesquels je travaille (sur qui pèse déjà la double malédiction de la dépendance et de la culpabilité) que l’attention se donne, s’accorde. On accorde son attention, et il s’agit donc bien d’un geste altruiste d’ouverture à l’autre. On fait don de son attention. Et je crois qu’il n’y a pas de réinvention sociale possible sans un renversement de cette tendance à la fois impatiente et nombriliste du manque d’attention. Si j’accorde mon attention à quelqu’un, si je l’observe ou l’écoute, je vais me demander comment il ou elle vit, se nourrit, attend, pense, s’habille, etc. Quel est son degré de maîtrise de la vie ? Or la facilité avec laquelle nous avons laissé la technologie coloniser notre quotidien et notre attention a parachevé l’uniformisation des arts de vivre. Nous nous laissons de moins en moins surprendre par l’autre. Je crois que c’est dans cette curiosité pour le savoir-vivre de l’autre que réside l’antidote à l’individualisme. C’est pourquoi j’ai tenté de soulever la question de la technologie, et celle de notre art de vivre avec la technologie, dans le roman, notamment avec l’invention du Kwish, qui est une technologie alternative poétique en laquelle on pourrait avoir pleinement confiance, et qui déplace donc notre rapport intuitif à la technologie, où le besoin est toujours mâtiné de méfiance. Dans le roman, la technologie permet d’atteindre un état de conscience propice au partage véritable (on parle bien d’une utopie !).
Ce qui est bien avec le protagoniste masculin c’est qu’il doute tout le temps. Le doute, les questionnements, les débats font avancer l’humain, peut-on espérer, mais là aussi, notre époque doit se dépolariser et décolérer avant d’y accéder, non ?
Pour moi la question du débat est conjointe de celle de l’attention et de la curiosité pour l’autre. Il ne peut pas y avoir débat s’il n’y pas de curiosité pour l’autre. C’est impossible. La colère, elle, est légitime. Par exemple, comme le dit Frédéric Lordon, je ne me définis pas comme « écoanxieux », mais comme « écofurieux ». L’attentisme et l’aveuglement de nos dirigeants génèrent de la colère. Et moi, cette colère, me donne de l’espoir. C’est une colère politique. J’ai eu de nombreuses conversations avec ce qu’on appelle communément des « complotistes » et bien souvent le constat de départ qu’ils font de l’état de notre société est très juste (ça dérape dès qu’on aborde les causes). Il y a beaucoup de colère et on doit la respecter. Je ne crois pas que notre société doive se dépolariser ou être moins dans l’extrême. Je crois qu’elle doit se défaire de l’influence de l’extrême droite, qui, peu à peu, soutenue par les nouveaux modes d’expression de la « pensée » via les médias et les technologies, s’est banalisée, décomplexée, à un point qu’on n’aurait jamais pu deviner il y a à peine vingt ans. À l’époque, un dirigeant d’extrême-droite en Europe était ostracisé ; aujourd’hui, tous les gouvernements collaborent avec l’extrême-droite. Le gouvernement centriste de Macron en France interdit des manifestions et revient sur le droit du sol. Trump, Milei, Bolsonaro, Netanyahou, l’extrême-droite est partout, revancharde, et elle est très organisée. Elle a investi de manière très disciplinée de nombreux champs abandonnés par l’intelligentsia de gauche. Elle a infusé sans se déclarer comme telle le quotidien des gens. Et c’est cet extrême qu’il faut combattre, à mon sens, celui qui diffuse de la peur et la haine de l’autre de manière obstinée.
Le roman pose de bonnes questions au bon moment. Si l’homme reste un loup pour l’homme, écrivait Thomas Hobbes, devra-t-on alors passer par le pire – conflits, haine, violence – avant d’arriver au meilleur et de raviver un certain espoir ?
Nous sommes dans le pire. Nous devons remonter nos manches et retrouver un peu d’espoir en l’humain. Je ne crois pas que l’homme soit un loup pour l’homme Au contraire. Ça fait également partie de la banalisation de la pensée de l’ultra droite. Moi je suis un rêveur. Je crois que l’humain n’est pas prédéfini. Il est ce qu’on en fait. Il n’est rien par essence. C’est précisément ce qui est abordé dans la dernière partie du roman avec le personnage de Vlatko, qui enseigne les principes de l’Enclave à Samuel : c’est notre responsabilité d’humain de croire en l’humain, sinon à quoi bon exister ?

Pierre Terzian
Devenir nombreux
Quidam éditeur
298 p.