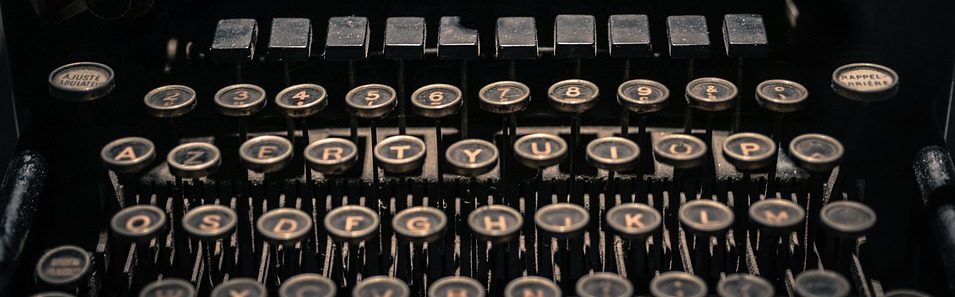Mireille Gagné a choisi la fable comme mode d’expression pour son premier roman, Le lièvre d’Amérique, publié par La Peuplade. Un genre qui convient parfaitement à la poète et nouvelliste qui s’inquiète de l’avenir. Le récit met en scène une femme obsédée, voire torturée, par son travail et un lièvre possédant, lui, l’instinct de survie.
Mireille Gagné vit à Québec, mais vient de l’Isle-aux-Grues, décor de son roman Le lièvre d’Amérique, fable mi-urbaine, mi-rurale. Un conte moderne qui porte message et qui tisse de forts liens avec sa propre vie, son passé, son travail.
« C’est un univers qui est proche de moi. Ça s’apparente à ce que j’écris. La fable est un procédé qui allait bien avec mon processus créatif. J’aime bien l’idée qu’il y ait une morale derrière. Je me disais qu’il fallait procéder à un ralentissement et la COVID est arrivée, ce qui a fait en sorte de faire me poser encore plus de questions sur le travail. »
Le travail n’est pas un sujet romanesque très populaire. Deux livres récents, et excellents, dont nous avons parlé sur En Toutes lettres – Les employés (Olga Ravn, La Peuplade) et Les agents (Grégoire Courtois, Le Quartanier) le font pourtant dans un esprit critique aigu à propos du néolibéralisme. Comme quoi tout ne roule pas rond au royaume des cubicules et des photocopieurs.
« C’est un thème pas trop accessible. Dans mon prochain recueil de poésie, il y a une section sur le bureau, aussi. C’est une réflexion que j’ai depuis quelque temps. En faisant des recherches sur le workaholisme, je suis tombée sur un texte parlant des 10 animaux qui dorment le moins sur la terre, dont le lièvre. »
Et Le lièvre d’Amérique confirme la nécessité d’aborder la question du travail avec un œil critique. Le livre met en scène le personnage de Diane, une workaholic qui ressemble un peu à sa créatrice. L’apparition d’une maladie chez Mireille Gagné l’a amenée à voir d’un autre œil sa volonté de tout faire en même temps et de se définir par le travail.
« C’est là que j’ai commencé à écrire. C’est sorti comme un volcan. Au travail, les gens au-dessus de nous pensent qu’on veut se surpasser constamment. On ne pense pas nécessairement comme eux. En Suisse, j’ai remarqué qu’il travaillent 45 heures, mais ils sont plus relax que nous. »
« J’essayais de voir quel vide je voulais remplir en travaillant autant, poursuit-elle. Je ne suis pas capable de faire une seule chose à la fois. Quand je suis à mon travail [en communication], je pense à mes écrits. Avec le personnage de Diane, j’ai voulu la pousser et faire briser son élastique pour voir ce qui aurait pu m’arriver si je n’avais pas ralenti mon rythme du travail. »
Diane aimerait avoir deux ou trois boulots pour se sentir vivante. Elle subit une chirurgie lui permettant de diminuer son temps de sommeil afin d’être plus performante. Dans l’extrait suivant, au rythme accéléré et ne comportant aucune ponctuation, le personnage devient une machine efficace réglée par les mathématiques.
« Pour calmer son anxiété de performance et économiser des secondes Diane compte perpétuellement le nombre de pas séparant son appartement de son travail de marches entre chacun des étages de secondes entre son bureau et celui de la femme qu’elle déteste le temps que ça lui prend pour remplir une bouteille d’eau attendre chez le médecin… »
L’autrice lui a, cependant, inventé un passé à l’opposé, celui d’une jeune fille ayant connu la splendeur de la nature et la liberté d’en profiter. Ses souvenirs sont surtout marqués par un garçon qui la fascinait, Eugène, l’air du large et un incendie qui a tout fait basculer. Ce n’est que des années plus tard que le surmenage l’affectera.
Diane crée un nouveau courriel destiné à son patron. Comme seul objet: Du vent. Dans le corps du texte: Encore du vent. Plein de vent tonitruant qui se fracasse contre les murs vitrés du bureau de son patron et qui les fait éclater sous la pression, projetant des débris sur tous ceux qu’elle côtoie sans vraiment les connaître depuis tant d’années. Envoyer.
On pourrait dire ici que la déesse de la chasse, Diane, redevient enfin elle-même après avoir été trop longtemps la cible de d’autres personnes ou emprises sociales.
« Il faut malheureusement et bien souvent frapper le mur avant de s’ouvrir les yeux et avancer, pense Mireille Gagné. J’aime l’idée de la proie et du prédateur. Le lièvre est une proie par excellence. Diane devient aussi une proie. Son patron profite d’elle. Qu’est-ce qui est acceptable au travail et qu’est-ce qui ne l’est plus? »
Retour aux sources
Quand le burn-out guette, il est peut-être temps de mettre un frein à la frénésie. Pour Mireille Gagné, il s’agissait de reconnecter avec sa vie d’avant.
Dans son très beau recueil de nouvelles, Le syndrome de takotsubo, le texte portant sur la chasse, Le cri n’est pas une parole hermétique, est la seule histoire réelle du livre.
« Je suis allé souvent chasser avec mon père. Mon père regardait le baromètre et les nuages dehors, puis il déclarait qu’il allait pleuvoir à telle heure. Et ça arrivait. J’aurais aimé apprendre ce langage du temps. »
Son roman est un livre dense, parcouru d’illustrations de pelage et d’inserts documentaire au sujet des caractéristiques du lièvre.
Quitter l’Isle-aux-Grues, dit-elle, a d’ailleurs représenté un deuil important dans la vie de la romancière. Elle y retourne souvent.
« J’y ai vécu des expériences presque surréalistes à la chasse avec mon père. J’aime beaucoup aller à l’Isle-aux-Grues et dans la nature. Le livre m’a fait prendre conscience de ça. J’aime ce ralentissement que je voudrais opérer en moi », dit-elle… sur le ton rapide qui est le sien!
Dans son deuxième recueil de poésie, Les hommes sont des chevreuils qui ne s’appartiennent pas, elle analysait aussi la frontière qui sépare la proie du prédateur.
« J’habite en ville et je suis heureuse que le bus passe à côté, mais sur mon terrain, je ne mets que des plantes, aucune fleur. J’essaie de conserver ma parcelle de sauvage en pleine banlieue. »
Rurale-urbaine, romancière-poète, elle estime qu’elle continuera de mélanger également les genres en création littéraire.
« Quand j’écris de la poésie, on dit que c’est narratif. Avec mon recueil de nouvelles, on parlait d’écriture poétique. Je veux confondre tous les styles. J’ai aimé écrire un roman avec de l’unité et en creusant les personnages. Souvent, c’est la première phrase du livre qui va donner la forme. »
Recueil Le ciel en blocs
La sortie de don prochain recueil de poésie, retardé par la COVID-19, est prévue pour le 30 septembre qui vient chez L’Hexagone. Poésie narrative, en effet, qui pose un regard ironique et acidulé sur nos vies compartimentés. Même si le nom de la marque d’un jouet fort prisé n’apparaît pas dans le livre, la couverture du recueil l’évoque assez clairement
« C’est une critique du monde de « Legos » dans lequel on vit. Une partie se déroule au bureau, une autre avec des voisins. C’est une critique de comment nous sommes façonnés dans le monde actuel. Écrire le recueil m’a beaucoup amusée. »
Même si le mot « art engagé » semble désuet aujourd’hui, on peut dire de Mireille Gagné qu’elle aime tout de même anticiper l’avenir pour prévoir les écueils à esquiver sur le fleuve avalant son île.
« J’aime critiquer ce qui m’entoure pour ne pas devenir tel que ce que je décris. Je l’intériorise pour ne pas m’égarer. J’ai souvent l’impression d’écrire ce que je vais vivre plus tard. Mon premier recueil de poésie, Les oies ne peuvent pas nous dire portait sur la mort de mon père qui n’est décédé que deux ans plus tard. »
ils ont dit que parler
n’est pas nécessaire
il faut suivre le plan
une étape à la fois
la fabrication d’un employé
ne devrait pas prendre trop
de temps / d’efforts / de blocs
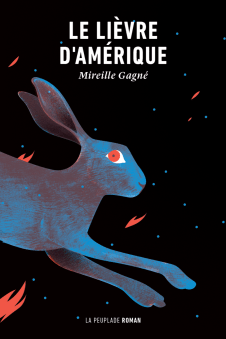
Mireille Gagné
Le lièvre d’Amérique
La Peuplade
160 pages

Mireille Gagné
Le ciel en blocs
L’Hexagone
80 pages